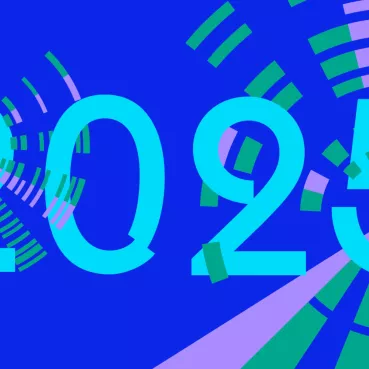Qui êtes-vous Aglaé Bory ?
Il y a quelques mois, pour sa première édition, le prix Caritas Photo Sociale a récompensé le travail d’Aglaé Bory. Reconnaissance bien méritée pour une photographe à l’écriture poétique, captivée par l’invisible et les paysages humains, et occasion rêvée pour se plonger dans l’univers de cette artiste dont la Collection possède un cliché de sa série inaugurale, « Corrélations ». Entretien.
Vous souvenez-vous de votre rencontre avec l’art ?
J’y ai été sensibilisée par mon milieu familial : mon père, ancien des Beaux-Arts, était professeur d’art appliqué. Plus tard, adolescente, alors que j’étais à la recherche de quelque chose qui me correspondait, j’ai découvert la photographie, notamment les photographes humanistes et le travail d’Arnaud Claass : j’ai fait l’expérience intuitive de l’image fixe, de sa relation au temps, de son cheminement solitaire.
Votre travail tourne autour de la figure humaine et donc de l’identité. Comment ce sujet s’est-il imposé à vous ?
C’est arrivé assez tôt. Il y a l’effet miroir : chercher dans les autres quelque chose de soi. C’est l’expérience humaine qui m’interroge. Le travail qui m’a permis d’affirmer mon écriture photographique, de cerner mon sujet, a été le travail d’autoportrait que j’ai fait avec ma fille, « Corrélations ». La figure humaine est centrale parce que je pense que c’est là que se fait le point de rencontre avec l’autre.
Dans cette série, on voit toujours le déclencheur dans votre main, comme pour en révéler la mise en scène. Quelle est la part de réalité, quelle est la part de fiction dans votre travail ?
Mon travail est exactement à la charnière des deux. Je pars du réel, mais je le décale. Le déclencheur montre que plutôt qu’un instant décisif dans la grande tradition de la photographie humaniste, il s’agit plutôt d’instants décidés, construits, reconstruits d’après le réel. C’est du faux-vrai, du mentir-vrai comme dirait Aragon. Le déclencheur est une nécessité technique ; il symbolise aussi le travail sur le lien en reliant ce qui se passe dans l’image au spectateur.
Il y a quelques mois, vous avez remporté le prix Caritas-Photo sociale avec votre série « Odyssées », qui évoque l’exil. Quelle a été votre démarche pour ce projet ?
Je travaillais depuis un certain temps avec des exilés, des demandeurs d’asile. J’avais été invitée par une association à Calais lorsqu’il y avait encore le camp et y avait été confrontée à de nombreux questionnements – photographier ou pas, comment être légitime, ce qu’on fait des images, ce qu’on leur fait dire, ce qu’on prend, ce qu’on donne… À Calais, j’ai eu l’impression qu’en photographiant ces gens, je les faisais exister d’une façon qui serait presque inaltérable : dans notre société, l’image est devenue la validation de la vie. Ensuite, j’ai eu une proposition du festival de littérature "Le Goût des autres" sur la thématique de l’exil. C’était un travail assez large sur ce que signifie être exilé de façon intérieure, en confrontant les participants à des paysages. C’est une partie de ce travail-là que j’ai proposé au prix Caritas. Les travaux sur la précarité et la misère sociale peuvent provoquer sur le public un sentiment d’effroi, de compassion, mais aussi un phénomène de lassitude et un sentiment d’impuissance, c’est peut-être pour cela qu’ils ont choisi mon travail qui offre un regard un peu plus poétique, moins ancré dans le réel.
L’inscription de l’individu dans son environnement est une thématique récurrente dans votre œuvre. Pourquoi ?
Je me suis toujours demandée ce qu’était un paysage. Existe-t-il sans nous, ou seulement par notre regard ? Le paysage, c’est une expérience. C’est une projection dans l’espace, dans le temps ; on y enfouit des choses que les autres ne voient pas. Ce que j’essaie de photographier, c’est cette conversation qu’on entretient avec un paysage : l’articulation entre visible et invisible.
C. Perrin