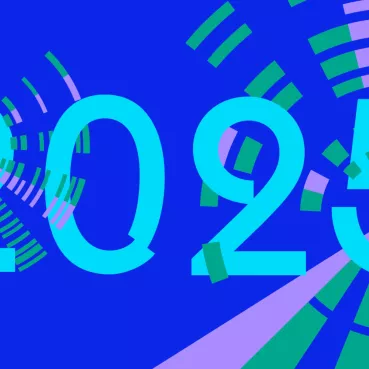![[Décryptage] Le fabuleux destin de l'art warli](/sites/default/files/styles/wide/public/data/actualites_a5888/fiche/153/full-XL_jivya_soma_mashe_fishnet_da4de.jpg?itok=1ikXXD7k)
[Décryptage] Le fabuleux destin de l'art warli
Popularisée par l'artiste aborigène Jivya Soma Masche (qui vient d'intégrer en 2015 la Collection Société Générale), la peinture warli s'exporte désormais au-delà des frontières de l'Inde. Retour sur un art tribal aux origines rupestres, et dont la forme contemporaine allie tradition et innovation, simplicité et virtuosité.
Moins connu que son homologue d'Australie, l'art aborigène indien trouve son expression la plus évidente dans la peinture warli et ses fameuses toiles blanches sur fond rouge. Ethnie de l'Etat de Maharashtra (150 km au nord de Bombay), les Warlis descendent des premiers habitants de la péninsule indienne, appelés « Adivasi ». On en compte aujourd'hui à peu près 300 000 membres, rassemblés dans de petits villages et vivant de l'élevage, de la pêche, et de l'agriculture. Animistes, ils vénèrent la nature qu'ils honorent notamment par une pratique rituelle du dessin.
De la case à la toile
Traditionnellement, la peinture warli n'a vocation à être ni contemplée ni conservée. Elle naît dans l'ombre des cases en torchis, exécutée par les femmes à l'occasion des mariages afin d'en garantir la stabilité. Il faut les imaginer chantant et dessinant à même les murs à l'aide d'un bambou sur lequel a été préalablement appliqué un mélange de pâte de riz blanche, d'eau et de gomme – un enduit de bouse de vache et de boue leur permettant d'obtenir un fond uni. Une fois la cérémonie passée, ces dessins à l'iconographie codifiée et rudimentaire s'effacent naturellement. On peint également pour les naissances et pour protéger les récoltes et la maison des mauvais esprits. Et ce toujours dans un cadre rituel, c'est-à-dire que l'acte, le moment de la réalisation prime sur la représentation finale et ses éventuelles considérations esthétiques.
Mais dans les années 1970, l'art warli connaît une métamorphose exceptionnelle sous l'impulsion conjointe du gouvernement indien, décidé à valoriser son patrimoine indigène, et de Jivya Soma Masche (né en 1934), premier homme à se consacrer à cet art exclusivement féminin. D'autres artistes suivront ses traces, et feront profiter la communauté warli d'une nouvelle source de revenus. Transcrite désormais sur toile, la peinture perd son caractère éphémère et votif (tout en maintenant l'essence d'une tradition ancestrale). L'acrylique vient prêter main forte aux matériaux naturels. Une expansion qui conduit l'art warli à Paris (pour des expositions au Quai Branly et à la Fondation Cartier en 2010 et 2012) et à Lyon, où l'un de ses plus grands représentants actuels, Shantaram Tumbada, signe sur la façade du musée urbain Tony Garnier une fresque monumentale. Après avoir délaissé cette pratique qui leur était originellement réservée, les femmes reprennent peu à peu leur place aux côtés des artistes hommes.
Raconter par le cercle, le triangle et le carré
Vassily Kandinsky rêvait de points et de lignes, Cézanne ne jurait que par la sphère et le cône. Les artistes warli, eux, déclinent à l'infini trois formes géométriques simples : le cercle (inspiré de l'observation de la nature), le carré (délimitant l'espace du sacré) et le triangle (qui sert à dessiner le corps humain : pointe vers le bas pour le buste, à l'inverse pour le bassin). Aucune perspective mais une palette réduite à deux couleurs et une surface plane où flottent des personnages à la manière de pictogrammes. La distance permet d’indiquer le temps. En cela, rien n'a changé depuis des siècles. Un vocabulaire stylisé animé par un réseau de lignes brisées qui donnent l'impression du mouvement. Un travail de longue haleine, extrêmement minutieux, mis au service d'un récit mythologique exhortant les puissances terrestres et célestes.
Aux motifs traditionnels – divinités et scènes quotidiennes : femme allaitant, hommes cultivant les rizières – s'ajoutent aujourd'hui des éléments de la vie moderne tels que l'arrivée du train dans la région ou la découverte de l'aviation, dépeinte avec humour par Shantaram Tumbada. On y mêle ses rêves et ses propres histoires aux esprits protecteurs (soleil, pluie). Le dieu tigre, invoqué pour protéger le bétail, côtoie le dieu paon, gage de prospérité, ou encore le dieu-cavalier à cinq têtes. Au centre de la toile, à l'intérieur d'un cadre ouvragé (le caukat ou chowk), trône la déesse-mère de la fécondité Palaghata (identifiable par ses membres-racines, sorte de râteaux simplifiés), ou son avatar : l'arbre de vie, dit Banyan. On y danse très souvent au son du tarpa (cet instrument à vent à la panse recourbée) des farandoles spiralées qui célèbrent l'harmonie entre les hommes et les forces cosmiques. Car, bien que chaque être ait une place délimitée sur la toile, tout demeure inextricablement lié chez ces peintres-paysans : le monde est en symbiose avec la nature.
Dans les filets de Jivya Soma Masche
Père de l'art warli contemporain, Jivya Soma Masche s'est fait connaître pour ses peintures représentant des filets de pêche, dômes monumentaux de dentelle blanche qui prennent quasiment tout le cadre. En 2015, la Société générale acquiert l'une de ces œuvres, Fishnet, pour sa collection. A l'extrémité du filet (aussi grand qu'une hutte ou qu'une voûte céleste), on devine le pêcheur attelé à sa tâche. Ainsi disproportionnés, les rapports d'échelle suggèrent la fragilité de l'homme face à l'océan immense. Dans la partie basse, l'eau fourmille de poissons. Terrifiante, la nature sait aussi se montrer généreuse. Les ondulations font vibrer la toile. «Jour et nuit il y a du mouvement. La vie est mouvement» rappelle Jivya Soma Masche, porte-parole du dynamisme créateur propre à la culture warli.